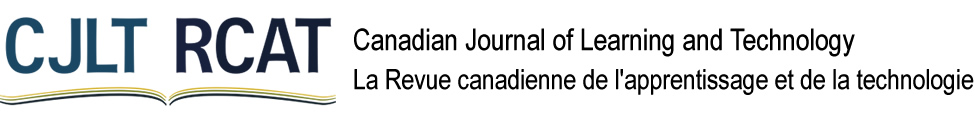
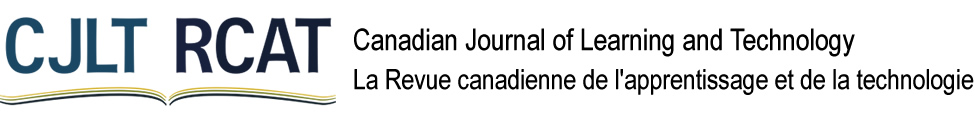
Martha Cleveland-Innes, Editor-in-Chief
Welcome to Volume 51, Issue 2 Canadian Journal of Learning and Technology (CJLT).
This journal has always supported research about learning, technology, and change. In the evolving landscape of education places and spaces, one truth is still emerging: learning is not confined to a traditional classroom or dictated by curriculum. It is shaped significantly by communities small and large, technologies of many types, and the beliefs and actions of those who teach and learn. Recent studies from Canada, France, Switzerland, and the United States offer a view to the continuing transformational change. Outlined are the problems, the promise, and the increasing complexity of techno-pedagogical reality.
In our Notes Section, Georges-Louis Baron and Solène Zablot from France explore the ecosystem of online teacher communities, as they produce and share resources. These collectives range from tightly organized “captive” groups to loosely formed “proto-communities,” embodying a spirit of pedagogical freedom that is uniquely French. Teachers are not mere consumers of curriculum; they are co-creators, shaping materials to fit their students’ needs and their own professional values. The authors argue that participatory research can amplify this action and offer a pathway to meaningfully influence policy and practice.
Our first empirical article brings us across the Atlantic, where the HyFlex model is gaining traction in postsecondary education, allowing students the freedom to choose between in-person and online learning. But as Laura Morrison and colleagues at Ontario Tech University reveal, flexibility comes at a cost. Their study, grounded in the Community of Inquiry framework, uncovers the logistical and technological hurdles that instructors face in non-lecture environments. Audio glitches, video lag, and the elusive goal of “mode neutrality” threaten to undermine the very flexibility HyFlex aims to provide. The solution, they suggest, is dependent upon institutional support beyond infrastructure in training and pedagogical design.
Natalie Nussli and Kevin Oh take the HyFlex conversation further, applying the POUR model (Perceivable, Operable, Understandable, Robust) to enhance digital accessibility. Their work bridges multiple frameworks: Universal Design, Mobile Seamless Learning, and Universal Design for Learning, which, in combination, create environments where all students can thrive. The journey of one instructor in Switzerland illustrates both the progress and the pitfalls of accessibility efforts. Students noticed the improvements, but navigation and participation barriers persisted. Their final message: accessibility must be intentional, iterative, and deeply embedded in course design.
Article three reviews immersive learning with virtual reality at Georgian College. James Doran and his team are pushing the boundaries of engagement through virtual reality. Their study compares desktop-based and immersive VR experiences in anatomy courses, finding that students using headsets reported significantly higher motivation and enjoyment. However, the promise of VR is tempered by practical challenges: individual bias, curriculum integration, and survey fatigue. Authors caution that without strategic planning and institutional buy-in, VR risks becoming a novelty rather than a transformative tool.
Finally, Jennifer Walsh-Marr and Shihua Tan offer a quiet revolution in academic literacy. Their case study at the University of British Columbia shows how social annotation, where students comment on texts asynchronously, can foster both individual understanding and communal learning. For first-year international students, this method provided a scaffold into academic discourse, allowing them to engage meaningfully with peers and texts. It’s a reminder that community isn’t just built in lecture halls; it can flourish in the margins of a shared document.
Taken together, these studies illuminate a new pedagogical paradigm that values flexibility, inclusivity, and the lived experiences of educators and learners. They challenge institutions to move beyond one-size-fits-all models and invest in the messy, human work of teaching and learning. Whether through teacher collectives in France or VR labs in Canada, the future of education lies not in technology alone, but in how we use it to empower communities and cultivate agency. The question now is not whether we can reimagine learning, but whether we will.
This editorial has benefited from the use of Grammarly and CoPilot to polish the language of the manuscript post creation. The author has created, reviewed, and shaped this commentary and takes full responsibility for it.
Bienvenue au volume 51, numéro 2 de la Revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie (RCAT).
Cette revue a toujours soutenu la recherche sur l’apprentissage, la technologie et le changement. Dans le paysage évolutif des lieux et espaces d’éducation, une vérité continue d’émerger : l’apprentissage n’est pas confiné à une salle de classe traditionnelle ou dicté par un programme d’études. Il est façonné de manière significative par les communautés, petites et grandes, les technologies de toutes sortes, ainsi que les croyances et les actions de ceux qui enseignent et apprennent. Des études récentes menées au Canada, en France, en Suisse et aux États-Unis offrent un aperçu du changement transformationnel en cours. Les problèmes, les promesses et la complexité croissante de la réalité techno-pédagogique sont décrits.
Dans notre section Notes, Georges-Louis Baron et Solène Zablot, de France, explorent l’écosystème des communautés d’enseignantes et enseignants en ligne, qui produisent et partagent des ressources. Ces collectifs vont de groupes "captifs" étroitement organisés à des "proto-communautés" peu structurées, incarnant un esprit de liberté pédagogique typiquement français. Les enseignantes et enseignants ne sont pas de simples consommatrices et consommateurs de programmes d’études ; ils sont des co-créatrices et co-créateurs, qui façonnent le matériel en fonction des besoins de leurs étudiantes et étudiants et de leurs propres valeurs professionnelles. L’autrice et l’auteur soutiennent que la recherche participative peut amplifier cette action et offrir une voie pour influencer de manière significative la politique et la pratique.
Notre premier article empirique nous amène de l’autre côté de l’Atlantique, où le modèle comodal gagne du terrain dans l’enseignement postsecondaire, offrant aux étudiantes et étudiants la liberté de choisir entre l’apprentissage en personne et l’apprentissage en ligne. Mais comme le révèlent Laura Morrison et ses collègues de l’Université technique de l’Ontario, la flexibilité a un coût. Leur étude, fondée sur le cadre de la communauté d’enquête, met en lumière les obstacles logistiques et technologiques auxquels les enseignantes et enseignants sont confrontés dans les environnements autres que les cours magistraux. Le problème audio, le décalage vidéo et l’objectif insaisissable de la "neutralité de mode" menacent de compromettre la flexibilité même que la formule comodale vise à fournir. La solution, suggèrent-ils, dépend du soutien institutionnel au-delà de l’infrastructure dans la formation et la conception pédagogique.
Natalie Nussli et Kevin Oh poussent plus loin la conversation sur la formule comodale en appliquant le modèle POUR (Perceivable, Operable, Understandable, Robust) pour améliorer l’accessibilité numérique. Leur travail fait le lien entre plusieurs cadres : conception universelle, apprentissage mobile sans interruption et conception universelle de l’apprentissage qui, combinés, créent des environnements où tous les étudiantes et étudiants peuvent s’épanouir. Le parcours d’un enseignant en Suisse illustre à la fois les progrès et les écueils des efforts en matière d’accessibilité. Les étudiantes et étudiants ont remarqué les améliorations, mais les obstacles à la navigation et à la participation ont persisté. Leur message final : l’accessibilité doit être intentionnelle, itérative et profondément ancrée dans la conception des cours.
L’article trois examine l’apprentissage immersif avec la réalité virtuelle (RV) au Georgian College. James Doran et son équipe repoussent les limites de l’engagement grâce à la réalité virtuelle. Leur étude compare les expériences de RV sur ordinateur et les expériences de RV immersive dans les cours d’anatomie, et constate que les étudiantes et étudiants qui utilisent des casques font état d’une motivation et d’un plaisir significativement plus élevés. Cependant, la promesse de la RV est tempérée par des défis pratiques : les biais individuels, l’intégration du programme d’études et la saturation des enquêtes. Les auteurs avertissent que sans planification stratégique et sans adhésion institutionnelle, la RV risque de devenir une nouveauté plutôt qu’un outil de transformation.
Enfin, Jennifer Walsh-Marr et Shihua Tan proposent une révolution tranquille dans le domaine de littératie académique. Leur étude de cas à l’université de Colombie-Britannique montre comment l’annotation sociale, où les étudiantes et étudiants commentent des textes de manière asynchrone, peut favoriser à la fois la compréhension individuelle et l’apprentissage collectif. Pour les étudiantes et étudiants étrangers de première année, cette méthode a servi d’échafaudage au discours académique, leur permettant de s’engager de manière significative avec leurs pairs et avec les textes. Cela nous rappelle que la communauté ne se construit pas seulement dans les auditoires, mais qu’elle peut s’épanouir dans les marges d’un document partagé.
Prises ensemble, ces études mettent en lumière un nouveau paradigme pédagogique qui valorise la flexibilité, l’inclusion et les expériences vécues par les enseignantes et enseignants ainsi que par les apprenantes et apprenants. Elles incitent les institutions à dépasser les modèles uniformisés et à investir dans le travail humain et désordonné de l’enseignement et de l’apprentissage. Qu’il s’agisse des collectifs d’enseignantes et enseignants en France ou des laboratoires de RV au Canada, l’avenir de l’éducation ne réside pas uniquement dans la technologie, mais dans la manière dont nous l’utilisons pour renforcer les communautés et cultiver l’autonomie. La question n’est pas de savoir si nous pouvons réimaginer l’apprentissage, mais si nous le ferons.
Cet éditorial a bénéficié de l’utilisation de Grammarly et de CoPilot pour peaufiner la langue du manuscrit après sa création. L’auteur a créé, révisé et façonné ce commentaire et en assume l’entière responsabilité.
Martha Cleveland-Innes is Professor of Open, Digital, and Distance Education at Athabasca University in Canada and Editor-in-Chief of the bilingual Canadian Journal of Learning and Technology. She is the co-author of open source publications The Guide to Blended Learning (2018), Participant Experience in an Inquiry-Based Massive Open Online Course (2022), and Principles of Blended Learning (2024). The Design of Digital Learning Environments: Online and Blended Applications of the Community of Inquiry was recently co-edited by Dr. Cleveland-Innes (Taylor & Francis, 2024). Her research interest areas include 1) online and blended learning, 2) artificial intelligence and online communities of inquiry, 3) higher education reform and lifelong learning, and 4) leadership in education. She is currently Visiting Professor of Pedagogy at Mid-Sweden University (2018-present). For more information, see her Athabasca faculty profile.
Martha Cleveland-Innes est professeure en éducation ouverte, numérique et à distance à l’Université Athabasca au Canada et rédactrice en chef de la revue bilingue La Revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie. Elle est coautrice des publications en accès libre The Guide to Blended Learning (2018), Participant Experience in an Inquiry-Based Massive Open Online Course (2022) et Principles of Blended Learning (2024). The Design of Digital Learning Environments: Online and Blended Applications of the Community of Inquiry a récemment été coédité par le Dr Cleveland-Innes (Taylor & Francis, 2024). Ses domaines de recherche comprennent 1) l’apprentissage en ligne et hybride, 2) l’intelligence artificielle et les communautés d’enquête en ligne, 3) la réforme de l’enseignement supérieur et l’apprentissage tout au long de la vie, et 4) le leadership dans l’éducation. Elle est actuellement professeure invitée en pédagogie à l’université Mid-Sweden (depuis 2018). Pour plus d’informations, consultez son profil sur le site de la faculté d’Athabasca.